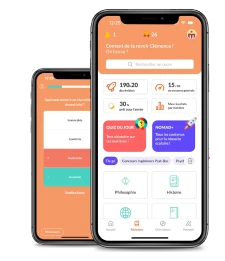Dans « Vérité et politique » (1967), Hannah Arendt interroge le rapport conflictuel de la politique à la vérité. Parce que la vérité s’impose rationnellement ou factuellement, alors que la politique repose sur la délibération, parce que « la vérité a un caractère despotique, quand on la considère du point de vue politique », il n’est pas étonnant que les politiques et les citoyens se méfient du « diseur de vérité » et que l’action politique s’autorise le recours au mensonge.
À partir de ce constat, on pourrait conclure que la vérité est faible ou que la politique est pleine de vilenies, mais tel n’est pas le propos de Arendt. Sa question est plutôt celle des limites de ce conflit : jusqu’où peut aller l’indifférence de la politique à la vérité ? La moderne manipulation de masse qui substitue à des vérités factuelles une version alternative de la réalité n’est-elle pas le symptôme d’une aggravation massive du rapport problématique de la politique à la vérité ? Mais les atteintes politiques à la vérité, aussi graves soient-elles, peuvent-elles véritablement atteindre leurs fins ? Si « la persuasion et la violence peuvent détruire la vérité, mais ne peuvent la remplacer », la dignité de la politique n’est-elle pas d’établir en son sein des institutions qui ont pour critère ultime la vérité ?
Dans « Du mensonge en politique » (1969), Arendt revient sur ces questions à l’occasion d’un cas particulier, la publication des documents du Pentagone qui font l’histoire des décisions prises par les États-Unis lors de la guerre du Vietnam. Ce qui la frappe, c’est que les mensonges politiques sont aussi des formes d’autosuggestion, que « les trompeurs ont commencé par s’illusionner eux-mêmes. » Comment est-il possible de faire abstraction de la réalité jusqu’à mener une guerre désastreuse contre un petit pays ? Dans quelle mesure les citoyens ont-ils été les dupes des discours publics ?