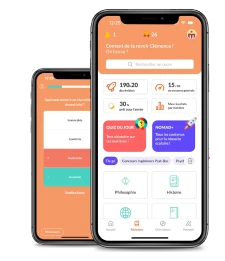Selon Mikhaïl Bakhtine, le carnaval a donné naissance à une littérature « carnavalisée » ce qui signifie porteuse d’une vision carnavalesque du monde. Cette influence du carnaval sur la littérature se repère dès l’Antiquité et jusqu’à la Renaissance puis, après une éclipse, elle réapparaît au XVIIIe et au XIXe siècle. Elle est visible à trois éléments essentiels : le privilège donné à l’actualité, le choix de l’invention libérée de la tradition et le mélange des styles et des voix (cf. L’Œuvre de François Rabelais et La Poétique de Dostoïevski).
La Renaissance constitue l’apogée de la vision carnavalesque du monde et Rabelais incarne cette culture comique populaire. Il laisse place à tout ce qu’inspire la place populaire en fête ; non seulement le langage grossier des injures et des plaisanteries, mais aussi les batailles, les mêlées en tous genres, l’acte carnavalesque par excellence, c’est-à-dire le détrônement et la ridiculisation, l’abolition de toute distance entre les hommes, l’excentricité, la profanation. Son style est caractéristique du « réalisme grotesque ».
Le Rêve d’un homme ridicule (1877) de F. Dostoïevski, fait partie, selon le critique Mikhaïl Bakhtine, des œuvres modernes directement inspirées du genre comico-sérieux de la satire ménippée, lui-même caractéristique de la vision du monde carnavalesque (cf. chap. IV de La Poétique de Dostoïevski). La ménippée est en effet un genre très ancien (Lucien, Sénèque), qui a encore des représentants au XVIIIe siècle (chez Voltaire et Diderot, par exemple) ou parmi les Romantiques (Hoffmann). Il a la particularité d'associer les fantasmagories les plus débridées, le réalisme grossier et les questions universelles ; c’est, par excellence, le lieu d’interrogations fondamentales sur le monde, la vérité, le bonheur, le salut, porté par un personnage solitaire qui doute.
Le récit se tient souvent à la frontière entre le rêve et la réalité, il décrit des états psychiques intermédiaires pendant lesquels le héros voyage à travers le temps et l’espace en mettant à l’épreuve ce qu’il croit. Toutes ces caractéristiques conviennent parfaitement à la nouvelle de Dostoïevski. Nous lisons la confession d’un homme qui vit au quatrième étage d’un meublé à Saint-Pétersbourg. Celui-ci raconte que la vérité lui a été révélée peu de temps avant, un 3 novembre. Commence alors un récit rétrospectif dans lequel nous apprenons que, ce soir-là, il avait décidé de se tuer ; mais il a rencontré juste avant, raconte-t-il, une petite fille en détresse. Il ne l’a pas aidée et est remonté dans son meublé. Alors, il s’est mis à penser. Tout le récit qui s’ensuit est le récit du rêve qu’il a fait cette nuit-là.
Dans ce rêve, il se suicide réellement, renaît, traverse les espaces infinis pour voir la Terre avant le péché. Il rêve qu’il est le visiteur qui corrompt les hommes. Il leur apporte le péché et fait de la terre ce qu’elle est désormais. Puis, il se réveille. La fin de la nouvelle nous ramène au matin de cette fameuse nuit de novembre. Mais la réalité ressemble à la fin du rêve : nous sommes sur la terre, entre le mal et le bien, à ceci près que le rêveur aime la réalité. Telle est la révélation : aimer l’homme tel qu’il est.
Ferdydurke est le titre étrange d’un roman de Witold Gombrowicz (1904-1969), auteur polonais reconnu. Très inspiré par Rabelais, le roman est écrit dans une veine comique et burlesque assez déconcertante. Il raconte l’aventure idiote d'un trentenaire qui retombe en enfance. Condamné à l’immaturité, le héros, Jojo, cherche à trouver sa voie dans un monde absurde et grimaçant où il est à la fois infantilisé et poussé à jouer un rôle.
L’inspiration carnavalesque est visible dans l’invention verbale, le goût de la déformation des mots (la « cuculisation »), surtout dans la mise en procès généralisée de toutes les formes de la culture officielle, notamment les professeurs (qui infantilisent les élèves), mais aussi la critique des postures intellectuelles en tout genre telles que l’éloge du progrès en particulier. Jojo est piégé dans un univers où l’on se contorsionne à qui mieux mieux pour prendre une « forme », c’est-à-dire une position quelconque masquant ses infirmités.
On peut lire dans le monde enfantin ainsi décrit la représentation imaginaire d’une Pologne d’après-guerre jalouse des place-fortes de la culture et s’efforçant, alors qu’elle est encore immature, de se faire une place dans le monde moderne en prenant des postures.