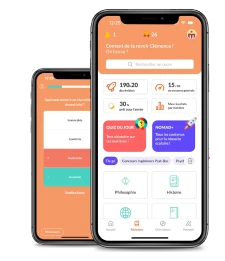Aux conditions de l’autonomie, Ricœur montre qu’il faut contraster plusieurs facteurs de vulnérabilité :
- L’incapacité physique d’agir : ou bien du fait de la maladie ou de la vieillesse, ou bien du fait de dommages infligés par les autres ;
- L'’incapacité à dire je : du fait de l’épreuve du temps, mais aussi de l’inégale « maîtrise de la parole », dont la cause n’est pas naturelle, mais culturelle, et qui se renforce parce que « se croire incapable de parler, c’est déjà être un infirme du langage » ;
- L’incapacité à revendiquer sa singularité : on s’identifie à des héros, des maîtres, on intériorise des normes extérieures et la psychanalyse freudienne montre comment le surmoi brise l’unité de la conscience en intériorisant les normes extérieures ;
- La difficulté fondamentale à s’insérer dans un ordre symbolique (l’ordre symbolique est un ordre partagé de lois et de normes dans lequel le sujet doit s’insérer, mais qu’il peut aussi investir personnellement).
Pour Ricœur, l’expérience du mal est cette expérience du self-arbitre où le moi n’est pas capable de résister à la séduction du dehors. L’aveu est alors un moment essentiel : celui où le sujet assume être responsable de ne pas avoir pensé, d’avoir été séduit (Le conflit des interprétations). Le mal physique (souffrir) est lié au mal moral (mal agir) dans la mesure où l’agir de l’un implique le pâtir d’autrui.
Dans ce contexte, le travail de la justice est double. Il vise :
- en amont, à éduquer à l’autonomie par une « pratique des médiations » et de l'éducation qui visent à fortifier les capacités linguistiques et symboliques ;
- en aval, par un acte impartial de juger qui vise à établir une reconnaissance mutuelle entre la victime et l’agresseur :
Je pense que l’acte de juger a atteint son but lorsque celui qui a, comme on dit, gagné son procès se sent capable de dire : mon adversaire, celui qui a perdu, demeure comme moi sujet de droit : sa cause méritait d’être entendue ; il avait des arguments plausibles et ceux-ci ont été entendus. Mais la reconnaissance ne serait complète que si la chose pouvait être dite par celui qui a perdu, celui à qui on a donné tort, le condamné ; il devrait pouvoir déclarer que la sentence qui lui donne tort n’est pas un acte de violence mais de reconnaissance.