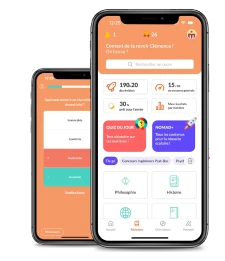Si l’État moderne est, comme le soutient Weber, une institution qui détient « le monopole de la violence physique légitime », l’idée d’une désobéissance légitime à l’État apparaît comme hautement problématique. D’abord parce que l’État ne conserve son « droit à la violence » qu’en dépossédant l’ensemble des individus et des autres groupes de ce droit. Ensuite, parce que si les actes de l’État, même violents — il faut ici penser non seulement à l’action de la police ou de l’armée, mais encore à la mise en œuvre du droit pénal, à l’impôt, etc. —, sont légitimes, cela signifie que son autorité ne s’exerce pas au moyen d’une pure et simple contrainte, mais à travers une forme d’obligation. Or, l’obligation implique le consentement des sujets qui y sont soumis, ainsi que la reconnaissance, envers celui qui en est la source, d’un droit à l’exercer. Si bien que l’exercice de la force par l’État n’est pas de l’ordre d’un simple fait, mais de l’ordre du droit et, puisque le droit implique l’obéissance de ceux qui y sont soumis, il ne semble pas qu’il soit permis de désobéir à l’État. Mais les citoyens ont-ils véritablement consenti à chaque acte d’un État ? Il peut arriver qu’un acte, une condamnation par exemple, ne semble pas juste à un individu ou à un groupe : n’aurait-il pas le droit, dans ce cas, de désobéir ? Peut-on alors s’autoriser d’une notion de justice différente de celle de l’État, voire de convictions morales, pour justifier sa désobéissance ? Encore faudrait-il montrer que l’acte est objectivement injuste, ce qui suppose, tâche difficile, d’identifier une norme universelle de la justice, transcendant les particularités et les contingences historiques, de la justice. S’il existe, dans tout État, un hiatus entre ce qui est légal, ce qui est inscrit dans le droit positif de cet État, et ce qui est légitime, ce qui est fondé en raison, ce qui devrait être inscrit dans le droit de ce même État, ce hiatus ne suffit pas à justifier une désobéissance, car il faut encore rendre raison — positivement — de la légitimité de l’acte de désobéissance : ce n’est pas parce que ce qui est légal n’est pas nécessairement légitime que la désobéissance à la loi positive est légitime. Si chacun pouvait désobéir selon son bon plaisir, l’État lui-même — qui suppose le renoncement des citoyens à une partie de leur liberté, en vue d’une existence collective apaisée — disparaîtrait. D’un côté, il se peut qu’en tant qu’État historiquement situé, avec d’éventuelles imperfections, l’État accomplisse des actes qui seraient illégitimes et qui justifieraient en principe la désobéissance ; de l’autre, si l’État est considéré comme une autorité légitime, il semble problématique d’autoriser une désobéissance qui, généralisée, conduirait à la destruction de la société. La question est ainsi de savoir quel critère permet de distinguer le légitime de l’illégitime, et s’il existe un critère extérieur à l’État qui justifierait d’éventuels actes illégaux.
Il convient d’abord d’interroger la source de la légitimité étatique : en quoi l’État implique-t-il, en principe, une obéissance absolue et universelle ? Cette légitimité ne vaut cependant que pour un État qui se conforme à sa finalité, à celle que lui ont confiée ses citoyens : désobéir à un État qui ne respecte pas ses propres normes ne semble-il pas non seulement légitime mais souhaitable ? En revanche, désobéir à un État en s’autorisant d’une norme qui n’est pas celle de l’État implique davantage de prudence : c’est pourquoi il faut enfin réfléchir à la possibilité de recourir à une norme extérieure à l’État pour justifier un acte de désobéissance.
Si désobéir à l’État semble, en principe, illégitime, c’est avant tout parce que l’État possède une légitimité intrinsèque qui fait de ses actes, plus que des actes de pure violence, des actes de droit. Or, un ordre ne peut être légitime s’il se limite à être une pure contrainte, extérieure, fondée sur la force physique ou l’intimidation. Si un voleur, braquant son pistolet sur ma poitrine, me demande de lui donner mon portefeuille, je suis contraint d’exécuter l’ordre qu’il m’intime, mais cet ordre n’est pas légitime. D’abord, parce que je ne reconnais pas au voleur d’autre autorité que la force physique. Ensuite, parce que la force physique, comme le montre Rousseau dans le livre I du Contrat social, ne fait pas droit : « céder à la force est un acte de nécessité, non de volonté ». Je désobéirai au voleur si j’en ai les moyens ; mais je ne désobéirai pas à un ordre que je considère comme légitime, même si j’en ai la possibilité, précisément car la légitimité implique le consentement du sujet, qui se soumet volontairement à l’autorité légitime. L’ordre légitime suscite une obéissance volontaire, l’ordre illégitime suscite une désobéissance volontaire. On peut considérer la loi comme un commandement, c’est-à-dire un ordre (ou un interdit) formulé par l’État, et en particulier sa puissance législative. La question est alors de savoir si la loi est légitime au point que toute désobéissance soit non seulement illégale, mais illégitime, c’est-à-dire contraire à la volonté du sujet qui s’y soumet.
C’est à cette question qu’ont tenté de répondre les théoriciens du contrat. Cette notion de droit privé, qui définit l’accord passé entre deux parties, engage en effet la volonté de ceux qui contractent. Ainsi, l’État est le produit d’un contrat entre les citoyens, qui se dessaisissent de leur liberté de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour satisfaire leurs désirs, en confiant le monopole de la violence à un souverain ; il faut donc reconnaître que les actes de ce souverain, même violent, sont légitimes. Dans le cas où l’État me donne l’ordre, par l’une de ses institutions reconnues, d’aller en prison, je peux matériellement désobéir ; mais il ne m’est pas permis de le faire de manière légitime, car l’acte de l’État engage alors ma volonté. C’est précisément ce qu’a tenté de penser Thomas Hobbes dans le chapitre XVI du Léviathan : selon lui, le Souverain, qui est le bénéficiaire du contrat, « représente » l’ensemble des citoyens qui ont passé un contrat entre eux de ne pas user « du droit de se gouverner soi-même ». L’État représente alors le peuple, c’est-à-dire l’ensemble des citoyens qui se sont assemblés et chacun des membres du peuple est l’auteur des actes du Souverain. C’est logiquement que Hobbes écrit au chapitre XXX qu’ « aucune loi ne peut être injuste » : car chaque loi, étant le commandement édicté par la puissance souveraine, est fondée sur ce mandat que chaque individu du peuple délègue au souverain ; sa légitimité réside dans la volonté de chaque citoyen qui consent à entrer dans l’État civil et qui consent, par conséquent, à ce que l’État utilise l’ensemble des moyens dont il dispose pour assurer la paix sociale. Dans ce contexte, désobéir à la loi ne peut être légitime : ce serait, en quelque sorte, renier sa propre volonté. Une telle approche suppose de distinguer la volonté de chaque individu par laquelle il consent au contrat et ses désirs particuliers : si je désire enfreindre la loi, je suis en contradiction avec ma volonté d’entrer dans un État civil.
Mais comment être certain que chaque acte du Souverain corresponde à la volonté de chaque individu contractant ? Il faut saisir alors le contenu de cette volonté : si les hommes s’assemblent, c’est pour sécuriser leur désir futur, toujours mis en danger dans un état de nature dépourvu d’autorité civile, c’est pour assurer une paix qui leur permettra de réaliser leurs désirs. C’est pourquoi, souligne Hobbes, la loi n’empêche pas les citoyens d’agir volontairement, mais tente de « les guider dans leur mouvement de sorte qu’ils ne se causent pas de torts à eux-mêmes » : rien ne serait pire, selon Hobbes, pour chaque individu, qu’un état d’insécurité permanente. Parce qu’il est plus rationnel de vivre dans un État que sans État, et parce qu’un État qui n’a pas les moyens de faire respecter la paix sociale n’est plus un État, il n’est pas légitime de désobéir à une sentence étatique ; la loi ne fait que ménager une coexistence des différents désirs. Il n’y a donc pas, pour Hobbes, de notions de justice dont chaque citoyen pourrait s’autoriser afin de justifier sa désobéissance : ce qui est juste, c’est ce qui est fixé par la loi, c’est-à-dire le commandement du Souverain ; y désobéir est un acte nécessairement injuste.
Mais que se passe-t-il si l’État ne parvient pas à assurer la paix civile ? Ou même lorsque ses actes mettent en péril cette sécurité ? Peut-on encore les considérer comme des ordres légitimes qui émanent en principe de la volonté des citoyens, fondement de leur légitimité ? C’est à cette question qu’Hobbes consacre le chapitre XXI du Léviathan. Il y souligne que la désobéissance et même la résistance à un ordre de l’État sont légitimes si et seulement si l’État attente à l’intégrité physique du citoyen : s’il m’ordonne de me suicider, ou s’il tente de m’assassiner, je suis en droit, explique Hobbes, de résister et de désobéir. En effet, aucun individu ne peut s’engager, par contrat, à renoncer au droit de se protéger soi-même : la légitime défense est un droit inaliénable et le contrat a précisément pour finalité de protéger l’intégrité physique de ceux qui s’y soumettent. Mais cela ne signifie pas que l’acte de l’État soit injuste : celui-ci est dans son bon droit d’anéantir les citoyens qu’il juge contraire à la paix civile. L’acte du citoyen n’est pas d’ailleurs juste, mais, écrit Hobbes, « non-juste ». En somme, si un individu, auteur d’un crime horrible, résiste à la police qui vient l’arrêter, il est dans son bon droit, même s’il ne peut s’autoriser des lois de l’État : car l’État, en s’en prenant à son intégrité physique, rétablit, pour cet individu, l’état de nature. La légitimité de sa désobéissance n’est pas fondée sur une loi de l’État, mais sur un droit extérieur à l’État (et même antérieur, puisqu’il s’agit d’un droit naturel). Ce n’est pas non plus un acte justifié moralement : la désobéissance n’est jamais permise selon une idée du juste ou de l’injuste, car c’est l’État qui est la source de cette détermination, mais seulement du point de vue de l’état de nature, lorsque l’exercice du droit de la légitime défense rétablit cet état où la différence entre le juste et l’injuste n’existe pas. Cette permission à la résistance n’est donc pas collective, elle ne peut se faire contre le souverain au nom d’un autre idéal : elle reste circonscrite à l’exercice de la légitime défense individuelle.
Cette perspective aboutit donc à une scission au sein du concept de légitimité : il faut distinguer une légitimité fondée sur le droit naturel, antérieur à l’État et, en un sens, opposable à l’État civil, et une légitimité fondée sur un contrat passé entre les citoyens, qui autorise les actes de l’État, même violents. Dans ce cadre, le même acte d’auto-défense est à la fois légitime (du point de vue du droit naturel) et illégitime (du point de vue du contrat). Mais en faisant de la seule désobéissance légitime une désobéissance fondée sur le droit naturel, et du droit naturel l’expression des rapports naturels des hommes abstraction faite de l’État civil, ne rabattons-nous pas la désobéissance légitime sur un simple fait de résistance ? Protéger sa vie ou sa liberté, indépendamment de questions morales, est-ce autre chose qu’en appeler à la force ? Cette perspective ne semble pas permettre de distinguer l’homme qui aurait de bonnes raisons de désobéir à l’État et celui qui le ferait en toute injustice (comme le criminel qui tente d’échapper à la police). Mais quel est donc le critère qui permet d’identifier ces « bonnes raisons » qui distinguent la désobéissance légitime de la rébellion illégitime ?
Il s’agit donc de savoir si l’on peut limiter la légitimité extérieure à l’État à l’idée de légitime défense. N’y a-t-il pas d’autres actes de l’État que l’agression physique auxquels je pourrai, légitimement, désobéir ? Sur quel principe peut-on fonder cette légitimité ?
Si Hobbes soutient que le critère de la légitimité dépend ou bien de la volonté du Souverain ou bien du droit naturel de chacun, c’est précisément pour éviter que chaque individu se considère, dans l’État, comme capable de distinguer lui-même le juste et l’injuste : la multiplication d’opinions divergentes aurait pour conséquence la multiplication des actes de désobéissance. Chacun désobéirait pour un motif différent, voire contraire, et ce serait la sédition généralisée. Une telle perspective pose cependant deux problèmes. Le premier est qu’elle fonde la légitimité des actes du Souverain sur un contrat hypothétique, anhistorique, et qui donc n’engage pas les citoyens, lesquels, en fait, vivent sous un État donné : si les citoyens ont tous implicitement la volonté de vivre dans la paix, consentent-ils pour autant à l’ensemble des actes de l’État, des actes que, par ailleurs, ils n’ont pas décidés dans leur particularité ? Comme le remarque Condorcet dans son article intitulé « Des Conventions nationales », l’obligation qui découle d’un engagement réciproque « ne lie que ceux qui se s’y sont volontairement soumis » : autrement dit, lorsque les générations de citoyens se renouvellent, le contrat initial ne vaut plus, puisqu’il n’engageait que les précédents citoyens. Il faut alors renouveler le contrat (tous les vingt ans, suggère Condorcet), par des assemblées constituantes chargées de revoir les lois, afin d’obtenir un nouveau consentement. Cette approche appelle deux remarques : d’abord la légitimité des actes de l’État n’est plus fondée dans la seule volonté abstraite de vivre en paix, mais dans l’« opinion du plus grand nombre », volonté concrète des citoyens ; et ensuite la légitime défense n’est plus le seul critère de la légitimité, l’ensemble des lois devant être validé par la pluralité. Cette argumentation n’étend pas la permission de désobéir à l’État lorsque chacun le souhaite : il est rationnel d’obéir à la volonté du plus grand nombre, comme à un commandement stable et sûr, mais elle déplace le fondement de la légitimité vers la volonté concrète du peuple, exprimée dans des débats, et souligne qu’il peut exister un hiatus entre les actes d’un gouvernement et ce qu’un peuple peut considérer comme légitime ; c’est à ce moment qu’il faut alors changer les lois. Et, puisqu’il est envisageable qu’une loi ne soit pas en conformité avec la volonté des citoyens, ne peut-on envisager également une légitimité à désobéir ?
Comme le remarque Montesquieu au début de L’Esprit des lois, l’on peut distinguer des « lois primitives », que les individus n’ont pas créées, mais qui sont fondées dans des rapports de justice possibles, et des lois positives, définies par chaque Souverain particulier. Les premières sont des lois fondées en raison, universelles, idéales dans la mesure où elles fixent le critère du juste et de l’injuste indépendamment des particularités de chaque État ; elles sont fondées sur des « rapports de justice possibles » et non réel. Par exemple, il est rationnellement juste que chacun reçoive ce qu’il mérite, bien que cela ne soit pas le cas dans la réalité. Or, comme le souligne Montesquieu, la différence entre le droit et le fait se traduit par l’inconstance de l’obéissance aux lois : les hommes « ne suivent pas constamment leur lois primitives, et celles mêmes qu’ils se donnent, ils ne les suivent pas toujours ». En somme, la différence, jamais effaçable, entre la loi telle qu’elle est formulée (ou formulable idéalement) et la loi telle qu’elle est appliquée rend possibles deux types de désobéissance : soit envers la loi positive, soit envers la loi primitive. Ainsi, dans la Déclaration des droits de l’homme de 1792, inspirée par Condorcet, et qui complète celle de 1789, était formulé un droit de résister à l’oppression ; cette dernière était définie ou bien « lorsque les droits naturels, civils et politique que [la société doit garantir » sont violés, ou bien « quand la loi est violée par les fonctionnaires publics dans son application à des faits particuliers ». Dans le premier cas, ce sont ce que Montesquieu nomme des « lois primitives » qui assurent la légitimité de la désobéissance ; dans le second cas, ce sont des lois positives qui ne sont pas respectées. On trouve ici une tentative inédite de fonder la légitimité de la désobéissance sur un concept d’oppression et sur une distinction entre les deux niveaux de droit que dégageait Montesquieu. Pour cela, il convient d’accepter que le juste ne se réduise pas à ce qu’énonce le Souverain ; et il convient de considérer également qu’un Souverain qui ne respecte pas ses engagements (ses propres lois) n’est pas dans son bon droit : il viole une loi primitive, celui du respect de ses promesses.
Le second cas (la désobéissance à un acte injuste du point de vue des lois mêmes de l'État) suppose de distinguer l’ordre du représentant de la loi (juge, gouvernant, fonctionnaire d’État) de la loi qu’il représente. Mais il semble légitime de désobéir à un État qui contredit ses propres lois. C’est ce cas qu’examine Spinoza dans le premier chapitre du livre 7 du Traité politique. Il propose une analogie entre l’épisode d’Ulysse et les sirènes et le cas d’un gouvernement qui donnerait à des citoyens ou à des magistrats des ordres contraires aux « lois fondamentales » de l’État. Ulysse avait donné un premier ordre, alors qu’il était en pleine possession de sa raison, à ses compagnons : celui de ne pas exécuter ses ordres une fois qu’il serait attaché au mât du navire ; une fois attaché et en proie aux séductions des sirènes, Ulysse formule un second ordre : celui de le détacher. Pour Spinoza, les compagnons d’Ulysse désobéissent légitimement au second ordre d’Ulysse : ce qui fonde leur légitimité, c’est l’ordre primitif, celui qui était fondé en raison. De même, un juge qui désobéit au caprice d’un Roi en s’autorisant d’une loi fixée antérieurement par ce Roi, est légitime dans son refus d’exécuter le second ordre. Mais l’analogie de Spinoza suggère un autre critère de la légitimité que celui de l’antériorité ou de la simple cohérence : celui de la rationalité. Il est légitime de désobéir à un État, si son ordre ne correspond pas à une loi de cet État fondée en raison, ce qui signifie qu’il est permis de désobéir à une loi qui serait irrationnelle. On peut actualiser cet exemple en pensant à un cas de désobéissance contemporain : si un fonctionnaire d’État désobéit à son supérieur en s’autorisant d’une loi présente dans la constitution, s’il montre que cet ordre est contraire à une des lois de la constitution, alors l’on peut dire que sa désobéissance est légitime, fondée dans une « loi fondamentale de l’État ». La désobéissance n’est alors légitime qu’à deux conditions : il faut pouvoir argumenter la légitimité de sa raison, et il faut pouvoir distinguer, parmi les différents décrets du Souverain, celui qui correspond à la « loi fondamentale » de l’État : de sorte que c’est bien le critère de la rationalité — un critère indépendant de la volonté du Souverain — qui détermine la légitimité de la désobéissance.
Mais que se passe-t-il lorsque cette loi fondamentale de l’État est elle-même injuste ? Dans le cas où la désobéissance s’autorise d’une loi de l’État, la légitimité possède un fondement encore interne à l’État. Mais en suggérant que la loi d’un État n’est pas toujours conforme aux lois de la raison, ne pouvons-nous pas légitimer une désobéissance aux lois fondamentales d’un État, lorsqu’elles ne sont plus rationnelles ? L’officier qui n’applique pas la loi d’un État totalitaire ou dictatorial, bien que cette loi soit inscrite dans sa constitution, n’agit-il pas en toute légitimité ? C’est dire que la raison dont il est question ne renvoie pas à un simple « calcul », mais bien à une instance capable de fixer des principes — et peut-être des principes moraux ? Ce type de cas invite à réfléchir à une source de légitimité externe à l’État : une légitimité qui justifierait, sous certaines conditions, la désobéissance civile.
Il convient désormais d’interroger frontalement la possibilité de désobéir légitimement à l’État en s’autorisant d’une norme externe à cet État. De ce point de vue, les recours légaux qui, dans certaines démocraties, sont des voies traditionnelles de l’opposition aux lois, comme les tribunaux supérieurs de justice ou, en France, la cour constitutionnelle, sont inopérants, puisqu’il s’agit de justifier une désobéissance à une loi sur un principe que l’État en question ne reconnaît pas. Selon Tocqueville, cette possibilité est cependant essentielle à la vie démocratique ; il s’agit en effet de concilier l’idée que c’est bien la majorité qui est à l’origine de l’autorité et celle que cette majorité n’a pas le droit de tout faire. Comment la majorité, à la source de l’autorité, peut-elle être donc limitée ? Cela implique de concevoir une légitimité extérieure à l’État : celle émanant non de telle ou telle majorité d’hommes, mais de « la majorité de tous les hommes », dont la loi est la justice. En somme, ce n’est pas parce qu’une majorité d’hommes, dans un pays donné, se met d’accord sur une loi qu’elle est, en droit, juste. « Quand donc je refuse d’obéir, écrit Tocqueville, à une loi injuste, je ne refuse point à la majorité le droit de commander, j’en appelle seulement de la souveraineté du peuple à la souveraineté du genre humain. » La désobéissance légitime n’est pas un simple refus de la loi de l’État : c’est un refus au nom d’une autre loi, c’est une manière de subordonner la loi de l’État à une loi plus générale. La désobéissance n’est pas dirigée contre l’autorité, ni même contre son principe, mais contre le contenu d’un de ses actes. Si une loi peut être injuste (contrairement à ce que dit Hobbes), c’est que le fondement de la justice ne réside pas uniquement dans la souveraineté d’un peuple déterminé, mais dans la souveraineté du genre humain, dans le droit égal de tous. La justice est ainsi « la borne de la loi de chaque peuple » : elle est une instance qui transcende les différents régimes juridiques. Toute la difficulté est à la fois d’énumérer ces critères universels de justice et de donner une consistance à cette idée de « souveraineté du genre humain ».
Une manière de fonder les critères universels de justice est de s’appuyer sur ces lois primitives évoquées par Montesquieu. En effet, elles ont l’avantage d’être transcendantes aux lois positives et donc de fournir un recours à la désobéissance à la loi établie. C’est pourquoi Locke fondait le « droit de résistance » sur les lois de nature : dans son Traité sur le gouvernement civil, Locke souligne que, si un gouvernement outrepasse ses prérogatives, use de la violence pour des fins qui ne sont pas celles stipulées par le contrat — la garantie de l’État civil — alors les individus ont un certain droit à résister. La loi de nature — qui a pour objet la conservation du genre humain — limite ainsi le pouvoir du gouvernement et autorise une forme de désobéissance à l’État. Il faut néanmoins que cette désobéissance soit, selon Locke, non seulement appuyée sur la loi de nature, mais collective. Il ne saurait y avoir de désobéissance personnelle, c’est-à-dire partielle. Si la désobéissance doit être légitime, elle doit pouvoir être partagée par des individus rationnels. Les critères de la légitimité sont la rationalité et la publicité de la désobéissance, qui engage la majorité du corps social : « Si le procédé injuste du Prince ou du Magistrat s’est étendu jusqu’au plus grand nombre des membres de la société, et a attaqué le corps du peuple ; ou si l’injustice et l’oppression ne sont tombées que sur peu de personnes, mais à l’égard de certaines choses qui sont de la dernière conséquence, en sorte que tous soient persuadés, en leur conscience, que leurs lois, leurs biens, leurs libertés, leurs vies sont en danger, et peut-être même leur religion, je ne saurais dire que ces sortes de gens ne doivent pas résister à une force si illicite dont on use contre eux ». Locke appuie la légitimité de la désobéissance à la loi ou au gouvernement sur une perception morale : la perception, par une pluralité d’individus concordants, d’une injustice peut justifier une désobéissance. En ce sens, c’est bien une instance morale, l’ensemble des consciences rationnelles, qui vient juger de la légitimité des actes politiques. Si le droit de résistance peut sonner comme un oxymore (il s’agit d’un droit de résister au droit), il se comprend si l’on saisit que le droit de l’État ne dépend de rien d’autre que de la légitimé que lui confère le peuple : celui-ci peut donc la lui opposer lorsque son action dépasse les critères de la justice naturelle.
La difficulté est que la désobéissance prend ici le contour d’une résistance qui, devant un pouvoir tyrannique qui refuserait d’abandonner son pouvoir, pourrait se tourner en révolution ; et si la révolution est bien de l’ordre de la désobéissance, elle n’a plus rien de légitime dans la mesure où elle s’extrait du droit ; elle n’est plus qu’un fait de résistance, une opposition de la force à la force. D’ailleurs, Locke souligne que le droit de résistance a quelque chose d’exceptionnel : c’est une dernière extrémité, lorsque les autres voies (amendement de la loi, changement de gouvernement) ne sont plus possibles. Afin d’amenuiser ce paradoxe, l’on peut réfléchir au concept de désobéissance civile, tel qu’il a été formulé au XXe siècle. La désobéissance civile se caractérise par un rapport particulier à la loi. Quelqu’un qui refuse d’obéir à une loi parce que, par exemple, il juge qu’elle est contraire à des objectifs environnementaux, ne nie pas le système juridique dans son entier, mais seulement le contenu de la loi, ce qui s’exprime non seulement dans le principe invoqué pour justifier la désobéissance, mais aussi dans la forme que prend cet acte illégal. Comme l’explique John Rawls, au paragraphe 55 de la Théorie de la justice, la « fidélité à la loi est exprimée par la nature publique et non violente de l’acte, par le fait qu’on est prêt à assumer les conséquences légales de sa conduite ». La loi est respectée dans son esprit plutôt que dans sa lettre. La publicité implique que l’acte peut être jugé et évalué par l’ensemble des citoyens ; ce n’est pas un acte secret de rébellion ; c’est un acte qui a une visée collective et engage une possible discussion. Même si l'acte de désobéissance est mis en œuvre de manière individuelle, il a vocation, par sa publicité, à alimenter un débat, à devenir une « affaire publique ». Cette désobéissance civile n’est pas non plus une simple objection de conscience, qui serait fondée sur une opinion subjective : l’opinion qui justifie la désobéissance a au moins la prétention à l’objectivité et à l’universalité. La non-violence ne rompt pas la paix sociale, et enfin l’engagement à assumer les conséquences légales d’une conduite souligne l’ambivalence de la désobéissance civile : elle reconnaît à l’autorité le droit de se servir de ses moyens de contrainte, elle reconnaît même la valeur de ce qui est légal, mais dénie le caractère totalement légitime de cette loi. Celui qui désobéit civilement fait donc appel au « sens commun de la justice » d’une communauté, loin de dénier tout sens de la justice : la désobéissance à l’État n’est légitime qu’en s’autorisant d’une certaine notion de justice et sous une certaine forme : celle de la publicité, de la démocratie.
Reste que la désobéissance peut aller jusqu’à remettre en cause non seulement le contenu d’une loi, mais la totalité d’un système juridique : la désobéissance non-violente de Gandhi, par exemple, ne remettait-elle pas en cause l’ensemble du système colonial ? Peut-on fonder la légitimité d’une désobéissance qui s’affranchit de la totalité des règles juridiques d’un État ? Un opposant politique, qui désobéit à un pouvoir dictatorial, ne le fait-il pas légitimement ? Si, par exemple, il exerce son droit de s’exprimer alors que certains sujets sont interdits dans la presse, cette désobéissance n’a-t-elle rien de légitime ? Elle peut sans doute être fondée sur les droits de l’homme et du citoyen qui garantissent la liberté de pensée et d’expression. Les droits de l’homme, comme les lois naturelles, ont un caractère universel. Mais comment s’exprime la légitimité des droits de l’homme ? C’est d’abord parce que chaque citoyen, tout en étant un citoyen d’un État, est aussi un citoyen du monde : il est membre d’une communauté internationale qui reconnaît certains droits inaliénables. Comme le souligne Habermas, ces droits n’ont pas besoin d’être fondés sur un accord universel du genre humain, sur des critères positifs de justice : il faut et il suffit que, devant certains actes d’agression, la majorité de la communauté internationale éprouve une indignation commune pour que se crée une « solidarité cosmopolitique » : un sentiment moral d’appartenance à un même monde, de partage de mêmes valeurs. Dès lors, l’on peut considérer, par exemple, qu’un membre d’une minorité qui désobéirait à un État coupable d’un crime de guerre envers cette minorité, quoiqu’il n’emporte pas l’adhésion de l’ensemble du pays, agit de manière légitime : à partir des droits de l’homme, valeurs reconnues par un ensemble de citoyens mondiaux solidaires, l’on peut dégager un critère universel de légitimité qui permette de distinguer la désobéissance légitime du simple refus criminel. Cela suppose de dissocier l’autonomie du citoyen de l’indépendance de l’État et donc de dépasser un concept restrictif de souveraineté. Si les droits de l’homme ne prescrivent pas à une nation comment elle doit se comporter, ils fixent des limites au-delà desquelles la désobéissance à l’État retrouve toute sa légitimité.
En somme, la désobéissance à l’État peut être légitime à plus d’un titre, si l’on distingue cette désobéissance d’un acte de pure sécession ou de pur refus de la loi. En effet, la finalité de l’État — garantir une paix sociale — semble interdire une désobéissance qui se ferait sur des bases purement subjectives ou aléatoires. Mais cette finalité n’implique-t-elle pas à l’inverse la possibilité d’une désobéissance civile ? L’écart entre le légal et le légitime fait qu’il est envisageable qu’une loi, un décret ou l’action d’un fonctionnaire étatique, tout en respectant la loi, ne soit pas tout à fait légitime. Soit parce que cet acte contrevient à une loi fondamentale de l’État : en ce cas, la désobéissance trouve sa légitimité à l’intérieur du système politico-juridique de l’État. Soit parce que cet acte contrevient à une loi primitive, une loi de nature ou un des droits de l’homme : dans ce cas, la désobéissance trouve sa légitimité à l’extérieur du système politico-juridique de l’État, ou bien dans les termes du contrat qui définissent la finalité de l’État, ou bien dans une notion plus vaste de justice qui engage l’ensemble de la communauté, ou bien dans une indignation morale universelle, partagée par les différents citoyens du monde solidaires.