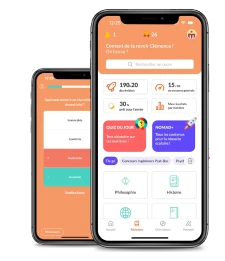« Cosmopolite », dans la langue politique courante, au début du XXe siècle, était souvent connoté péjorativement : le terme servait en particulier, dans les milieux antisémites, à désigner des citoyens français de fraîche date, caractérisés par le caractère international de leurs relations d’affaire ou d’estime. Cet usage dépréciatif dissimule pourtant un concept qui a toute sa noblesse, apparu dans la langue française en 1784, sous l’influence de la pensée de Kant dans l’Idée d’une histoire universelle d’un point de vue cosmopolitique.
« Cosmopolitisme », dans toute sa rigueur, désigne alors l’élargissement politique de notre regard, tendant vers une forme d’universalisation du jugement, que la Critique de la faculté de juger caractérise en son paragraphe 40 : l’élargissement de notre regard de citoyen suppose d’abord de se rendre capable de « toujours penser par soi-même », c’est-à-dire de former avec constance un jugement exempt de tout préjugé ; il implique ensuite de « penser en se mettant à la place de tout autre être humain », c’est-à-dire de s’élever au-delà des conditions subjectives, d’ordre privé, du jugement.
Cet élargissement suppose enfin de « toujours penser en accord avec soi-même », ce qui pose un problème de compatibilité, en un sens, avec les maximes précédentes, et montre à quel point, selon les mots mêmes de Kant, cette troisième maxime « est la plus difficile à mettre en œuvre ». Reste que le cosmopolitisme est à ce prix, c’est-à-dire notre capacité à comprendre et prendre en compte la primauté de notre appartenance à l’humanité avant tout autre considération politique. Notre humanité nous oblige : telle est la leçon du cosmopolitisme, aussi bien dans son expression stoïcienne – celle de l’empereur Marc Aurèle – que dans son expression kantienne, en 1784.
Politiques du monde
📝 Mini-cours GRATUIT
Un monde technologique ?
Les ruptures de l’histoire mondiale ont été expliquées par Marx, au XIXe siècle, comme des ruptures des conditions techniques de production : si le monde a été bouleversé, si des révolutions affectant la condition humaine dans son intégralité ont pu se développer, c’est d’abord, selon l’auteur du Capital, parce qu’une rupture dans l’histoire des techniques de production détermine les sociétés humaines.
Ainsi, la révolution néolithique – bouleversement des techniques agricoles – conduit à la sédentarisation des populations et met fin à la préhistoire. Ainsi, la révolution industrielle – bouleversement induit par l’invention de la machine à vapeur – induit une redistribution des territoires et de la démographie, tout en provoquant une aliénation massive du prolétariat. Du moins, telle est l’analyse marxiste dominante dans les sciences humaines et sociales jusqu’au milieu du XXe siècle.
Mais en 1958, dans La Condition humaine, Hannah Arendt oppose « le monde technologique dans lequel nous vivons, ou peut-être commençons à vivre » au « monde mécanique » antérieur, qui renvoie au monde industriel de la mécanisation des processus de travail, typique de la révolution industrielle du XIXe siècle. Selon Arendt, le monde dans lequel nous vivons désormais marque un changement de puissance de l’humanité, peut-être encore invisible en 1958 mais déjà à l’œuvre, caractérisé par « la création de processus naturels qui sont amenés dans l’artifice humain ». On doit donc, certes, concéder à l’analyse marxiste que la révolution industrielle a été une rupture décisive. Mais la substitution d’un « monde technologique » au « monde mécanique » est peut-être plus décisive encore, alors que les analyses marxistes la conçoivent comme une simple queue de comète de la révolution mécaniste du XIXe siècle. Ainsi, l’opposition, sous la plume d’Arendt, entre « monde mécanique » et « monde technologique », est à bien des égards une invitation discrète à renouveler en profondeur le regard que nous portons sur l’histoire politique et sociale de l’humanité.
📄 Annales PREMIUM

Annales EM Lyon BS Culture générale 2022

Annales EM Lyon BS Culture générale 2016
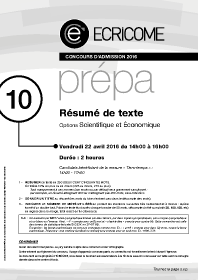
Annales ECRICOME 2016