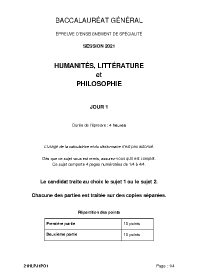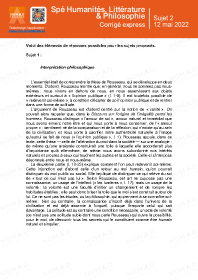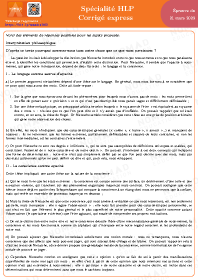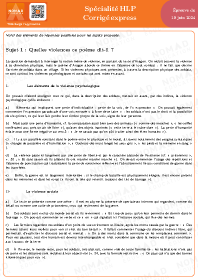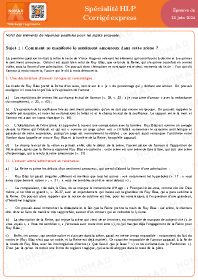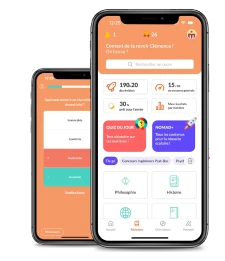La dystopie : une contre-utopie
La dystopie est une contre-utopie : elle emprunte à l'utopie son discours (l'invention d'une société qui n'existe pas) afin de montrer que l'idéal d'une société programmée pour être parfaite se retourne en une société violente, liberticide.
Brave New World d'Aldous Huxley (1932)
Dans Brave new world (Le Meilleur des mondes, 1932), Aldous Huxley dépeint une société entièrement programmée et fondée sur un eugénisme radical : les êtres humains sont produits dans des bocaux au sein de laboratoires, pour former des classes distinctes et correspondant aux différentes tâches dans le monde du travail (commandement, ou simple exécution). La dystopie pousse à l'excès l'idéologie du progrès scientifique pour montrer qu'elle est source de déshumanisation : les individus n'ont plus de sentiments personnels.
1984 de George Orwell (1949)
Dans 1984 (1949), George Orwell construit, à partir de l'exemple des sociétés totalitaires, l'image d'une société de contrôle où le personnage, Winston Smith, seul résistant, est finalement écrasé par la torture. Dans ses descriptions, Orwell met l'accent :
- Sur l'importance du contrôle permanent (figure de Big Brother) ;
- Sur le rôle de la guerre, considérée comme la raison du pouvoir omniscient de l'État ;
- Sur le rôle de la langue qui, façonnée par le régime, devient le vecteur de l'idéologie.
L'analyse de Victor Klemperer
Cf. la Langue du IIIe Reich de Victor Klemperer (1947), philologue et linguiste allemand, qui montre que la structure de la langue allemande utilisée par le national-socialisme devient vectrice de l'idéologie totalitaire. Sa syntaxe est déconstruite (usage de l'euphémisme, importance des formules impératives…) et fait pénétrer de manière inconsciente l'idéologie dans les esprits :
« les mots peuvent être comme de minuscules doses d'arsenic : on les avale sans y prendre garde, ils semblent ne faire aucun effet, et voilà qu'après quelque temps l'effet toxique se fait sentir ».
La résistance face à l'endoctrinement
Face à l'endoctrinement, la littérature (Winston Smith résiste en écrivant un journal) et l'engagement politique semblent les seules réactions possibles.